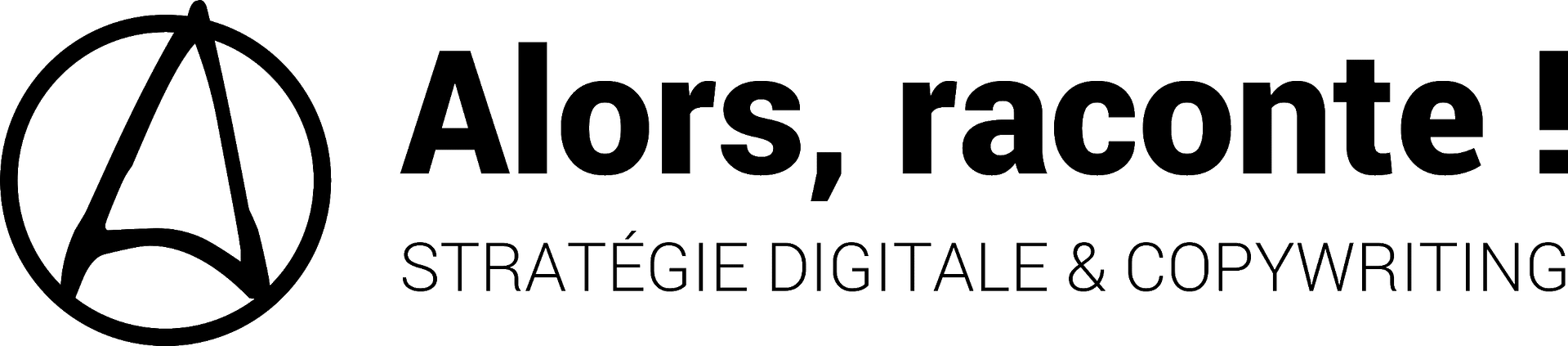Depuis maintenant un mois, un film fait sensation. Au moins dans le petit milieu des professionnels du cinéma belge. Ce film, c’est La nuit se traîne, de Michiel Blanchart. Voilà un film comme on n’en voit pas beaucoup dans notre petit paysage cinématographique. Un film qui adopte tous les standards d’une production commerciale de haut niveau, tout en étant tourné au coeur de Bruxelles.
Et, divine surprise, le film est un succès ! Du genre qu’on n’a plus vraiment vu depuis longtemps dans nos salles pour un film belge.
Et donc, là, logiquement, on se tourne vers les chiffres. Et on se rend compte qu’à ce jour, le film dépasse la barre des 30.000 spectateurs. Selon les calculs savants des professionnels, il terminera à 40.000.
40.000 spectateurs, c’est loin des chiffres dont pouvait s’enorgueillir certains films belges francophones il y a encore 15 ou 20 ans. Voire même juste avant le Covid, où un film comme Mon Ket dépassait encore les 100.000 spectateurs en Belgique, et le double en France. Et ce n’est en tout cas clairement pas assez pour couvrir les près de 5 millions d’euros de budget du film, même avec les recettes de la sortie française, qui plafonnent à 100.000 spectateurs.
Alors, en quoi ce film, nonobstant ses qualités est-il vu comme un succès ?
Le succès, à la belge
C’est d’abord que, si le cinéma belge francophone n’est en soi pas en crise, il est tout de même en instance de divorce avec ses spectateurs. Les films belges qui arrivent à atteindre les 10.000 spectateurs se comptent sur les doigts d’une main chaque année. Même la télévision nationale, si prompte à acheter à grand prix des documentaires Youtube, relègue maintenant quasiment tous les films belges sur La Trois, sa chaîne dite de prestige, mais dont tout le monde sait qu’elle est un placard.
Alors, posons-nous à nouveau cette question : dans ce moment où le cinéma intéresse moins, qu’est-ce qu’un succès, sur quelles bases le jauger ? Et puis, peut-être, comment relever la barre ?
Et, avant de commencer, posons aussi une distinction. Le cinéma dont on va parler ici, c’est la fiction en prises de vues réelles. Parce que du côté de l’animation, les choses vont plutôt bien. Les films familiaux du studios nWave battent les records de box office pour un film belge. Ou les films de La Boîte … production, d’Arnaud De Muynck, qui arrivent facilement à flirter avec les 150.000 à 200.000 spectateurs Belgique et France confondus, et arrivent à être rentables.
Revenons à notre question, qu’est-ce qu’un succès ?
Qui définit le succès ?
On le voit, la question du succès est d’abord relative. Par rapport à des chiffres du début du siècle, les chiffres de fréquentation de La nuit se traîne n’ont rien d’impressionnant. Si succès il y a, c’est d’abord par rapport à la situation morose à laquelle, petit à petit, tout le monde de l’audiovisuel s’habitue. Et il est aussi particulier au petit monde qui l’édicte, ce succès.
Car en fait, il n’y a que pour le monde des professionnels de la profession que ce succès en est un. Pour le commun des mortels, La nuit se traîne est un film comme un autre, qui fait peut-être soulever un sourcil quand on découvre que c’est un film belge. Mais, à l’aune des résultats de films internationaux, La nuit se traîne fait toujours pâle figure.
Alors, revenons-en aux critères bassement objectifs : l’argent.
Succès vs rentabilité
Si l’on s’en tient à ses seules performances en salles en Belgique et en France, le film rapportera à ses producteurs quelque-chose comme 230.000 € à 250.000 €. Bien sûr, la carrière d’un film, surtout aujourd’hui, ne s’arrête pas à la salle : il y a les ventes télé, les ventes aux plateformes (plus de ventes DVD, malheureusement, où un film pouvait se “refaire” sur un marché national, et même devenir culte). Et puis il y a les droits dérivés, qui reviennent aux producteurs tout au long de la carrière du film.
Sauf que,
La carrière en salles sert tout de même encore d’étalon pour la suite de la carrière commerciale du film, et que
Une part importante des ventes télés ont déjà été intégrées dans le budget du film, par l’intermédiaire des préachats.
Il faut donc ici revenir au processus de production d’un film, et à sa logique un brin perverse désormais acceptée par tous.
Le rentabilité des producteurs
Dans nos pays, un film est très rarement produit par l’argent du producteur lui-même. La grande part de la production provient de fonds divers d’aides à la production, de systèmes de réductions d’impôts, de préachats par des diffuseurs ultérieurs comme les télés ou les plateformes - ce qu’elles sont obligées de faire par la loi - et plein d’autres mécanismes plus ou moins complexes.
Et, dans le budget de production d’un film, le producteur prend sa propre marge, et se rémunère pour son propre travail et celui de son équipe.
Cela ne veut pas dire que le producteur ne prend aucun risque dans le processus de production, loin de là. Il prend la plupart du temps un risque sur une bonne partie de sa marge. Et un risque de trésorerie, qu’il ne faut pas oublier.
Mais il n’empêche : le producteur se rémunère à la base de la production du film. Il fait un bénéfice sur l’opération, que le film soit un succès ou non.
Son incitant à lui, c’est donc de faire des films toujours plus chers, puisque cela augmentera mécaniquement ses bénéfices. Ce qui m’a fait dire, il y a quelques temps déjà, que le concept de film “trop cher” n’existait en fait pas. C’est la somme d’argent que tu arrives à lever qui détermine le budget de ton film. Et pas l’inverse.
C’est cela qui peut justifier ce qui paraît à première vue une aberration: qu’un film qui soit si manifestement déficitaire soit vu comme un succès.
Dans un monde … où aucun film n’est rentable.
Là où cette logique devient problématique, c’est que, dans le cas du cinéma belge francophone, tous les films sans exception sont dans cette situation. Et fondamentalement, le fait est aujourd’hui accepté que les films belges francophones n’ont pas vocation à rentrer dans leurs frais.
Sur des marchés voisins, comme la France ou l’Allemagne, il y a certes aussi une grosse proportion de films déficitaires. Et c’est normal. L’art reste une affaire d’incertitude et de prototype. Et si tous les films devaient être bénéficiaires, il n’y aurait tout simplement plus de cinéma puisque de nouveaux auteurs devraient dès leur premier film faire un film rentable.
Cependant, dans ces marchés, il y a une marge de films, souvent honnis (rappelons nous de la haine irrationnelle autour du dernier Asterix) qui, eux, sont fortement bénéficiaires. Et dont les bénéfices rapportent à tout le système.
Chez nous, ces films-là n’existent pas.
Et ça, par contre, c’est un problème.
Parce que, sur le long terme, cela finit par assécher les sources de financement. On a beau obliger certains opérateurs à participer au modèle de financement du cinéma, ceux qui le pourront s’en détourneront.
L’affaire Netflix
Comme le fait Netflix en ce moment, en attaquant le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles pour le taux de participation à la production nationale qu’elle lui réclame. Taux pourtant nettement inférieur à celui de la France par exemple. En Belgique francophone, le taux de financement sera à terme de 9.5% du chiffre d’affaire de Netflix sur le territoire. En France, il est de 20%.
On pourrait y voir, comme le font les insiders de la profession, une manoeuvre cynique de Netflix, qui attaque le petit poucet de l’Union Européenne sur l’application d’une loi Européenne qu’elle ne veut pas voir appliquée. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas attaquer La Flandre, ou le Danemark ?
Peut-être tout simplement parce les raisons de Netflix sont ailleurs. La règle de ces obligations de financement est claire : soit le financement est direct, c’est à dire que l’opérateur finance directement les productions qu’il choisit, soit il met la somme réclamée au pot commun, dans notre cas au Centre du Cinéma et de l’audiovisuel.
Dans une très grande part des autres marchés, Netflix arrive sans peine à remplir ses obligations avec des productions propres. En France, par exemple, elle dépasse allègrement le 20% de son chiffre d’affaire réinvestis avec des productions comme Lupin, Tapie, En Place, Sous la Seine et j’en passe. Idem pour la Flandre. Mais en Belgique Francophone ? Qui pour produire une fiction glocale comme Netflix en est friande ? Car, ce que ne veut pas faire Netflix, c’est tout simplement mettre cet argent au pot d’un système qui, in fine, ne lui rapportera rien.
La voie de la rentabilité…
Le risque, c’est qu’il ne reste donc, pour produire en Belgique, que les guichets de financements mis en place. Soutiens qui ne favorisent, parce que c’est leur fonction, qu’un cinéma d’auteur et la coproduction internationale.
On le sait tous, ce qui manque à la Belgique pour retourner cette conjoncture, c’est de trouver la formule du succès commercial.
Formule que La Nuit se Traine s’est attelée à chercher. En n’atteignant donc que les chiffres que nous avons mentionné plus haut.
Alors, inversons le raisonnement. Prenons La Nuit Se Traîne comme étalon de ce qu’il est possible de générer comme Box Office avec un film belge aux ambitions commerciales modérées.
Ce box office, c’est donc environ 150.000 spectateurs, soit environ 250.000 € de bénéfice net pour le producteur. Or, des films comme cela, on en produit déjà. Ce sont les fameuses productions légères, dont les budgets finaux, sauf exceptions, tournent autour des 300.000€. Sachant qu’une partie du budget est souvent constituée de préachats aux télévisions, non remboursables, on arrive bien à un retour de 250.000€ pour que le film rentre dans ses frais.
… est encore loin.
Sauf que, même là, ce n’est jamais arrivé. Entre un L’employée du mois qui n’attire même pas un distributeur, Une vie démente qui a plafonné à 26.000 spectateurs, ou Fils de Plouc qui a calé à un peu plus de 4.000, on voit que le chemin est long. Et les exemples les plus récents comme The Belgian Wave ou Il pleut dans la maison ne vont pas relever la barre.
A qui, à quoi la faute ? Ce qu’on peut constater, c’est que les films sortis de cette filière de la production légère ne correspondent pas vraiment aux critères du film à potentiel commercial. Si il y a certes des comédies dans la liste, par exemple, elles sont soit dans la logique du cinéma d’auteur, soit dans une logique de la marge.
Or, il n’y a que deux genres cinématographiques qui permettent une structure de production légère tout en espérant un certain retour commercial : la comédie et l’horreur. Force est de constater que ni l’une ni l’autre ne sort, jusqu’à présent, du chaudron de la production légère.
Et ce n’est pas faute de volonté ! Le Centre du Cinéma fait tout pour faire émerger une vague de comédies. Wallimage, le fonds wallon, soutient lui aussi le cinéma de genre dès qu’un projet lui est proposé.
Mais le problème, on l’a déjà vu, c’est que la comédie ne sort pas du vide. Ce sont des mécaniques précises, qui se travaillent sur le temps, en amont. Et l’horreur est un genre très codifié qui, contrairement aux apparences, évolue très vite.
Il est clair que la solution à cette quadrature du cercle de la rentabilité des films dans un petit marché se trouve dans ces genres. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui tout le monde le sait. La réalité, pourtant, est que nous n’avons aucune réelle tradition dans ces genres. Les films que nous y avons produit, y compris ceux qui sont vus comme des succès - C’est arrivé près de chez vous, Dikkenek, Mon Ket - sont tous hors des standards du genre, des heureux accidents de parcours, non réplicables.
La nuit se traîne montre qu’il y a la voie d’un possible pour un cinéma commercial en Belgique Francophone. Il ne l’a pas encore atteint. Mais si il arrive à ouvrir les esprits sur la possibilité d’une autonomie commerciale dont notre industrie a tellement besoin pour ne pas se faire engloutir sous le poids de la coproduction minoritaire, alors, oui, on peut parler de succès.