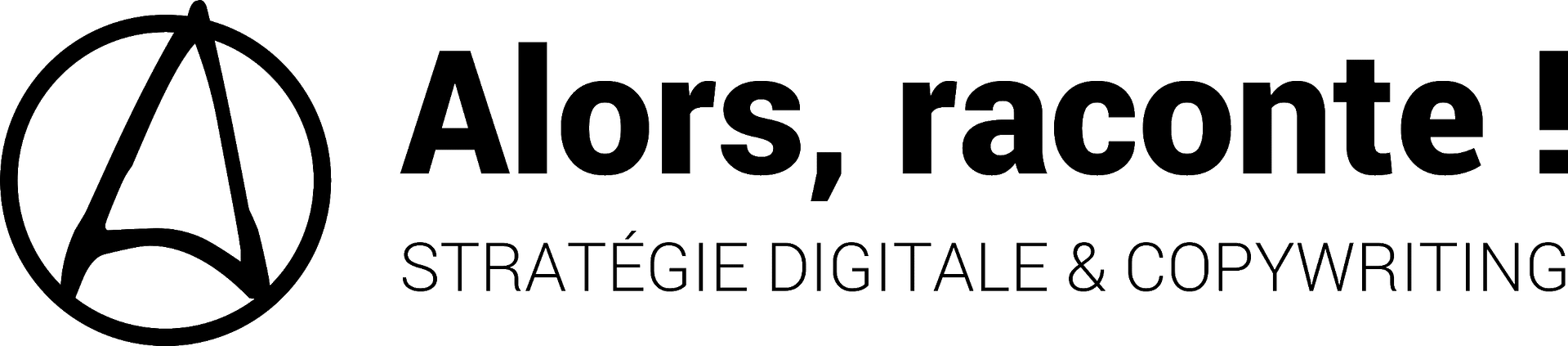Ce mercredi 22 janvier sortait dans les salles belges le film Maldoror de Fabrice du Welz. Le film a fait le trajet promotionnel somme toute classique, entre première dans un festival prestigieux (Venise dans ce cas-ci), tournée presse entre le réalisateur et l’acteur principal, et circuit d’avant premières.
Avec un retour critique relativement satisfaisant autant en Belgique qu’en France.
Mais derrière ces retours critiques presque unanimes pour reconnaître les qualités et défauts cinématographiques du film, un autre type de discours est bien vite venu se joindre à la danse : le discours de la morale.
“Fallait-il faire un film sur l’affaire Dutroux ?”
Cela a commencé par l’une de ces émissions de radio sensées recueillir les réactions du “grand public”, qui a jugé bon de faire une émission sur “fallait-il faire un film sur l’affaire Dutroux” ? Car oui, si vous ne le saviez pas, Maldoror est librement inspiré par le scandale judiciaire qui a secoué la Belgique il y a 30 ans de cela.
Ensuite, le mercredi 22, jour de la sortie du film, c’est au tour du critique star de la RTBF, peut-être le plus écouté de Belgique francophone, d’étriller le film pour les libertés qu’il prend avec l’affaire réelle, l’accusant d’accréditer des thèses complotistes.
Enfin, le vendredi 24, juste avant le premier week-end d’exploitation du film, week-end décisif pour la carrière d’un film, le journal Le Soir publie un article assez hallucinant, titré “Si vous voulez comprendre l’Affaire Dutroux, n’allez pas voir ce film”.
Le cinéma contre “les faits”
L’auteur de cette sanction, de cette injonction à ne pas aller voir un film belge ? Un avocat. Certes plus que respectable, Maître Georges Henri Beauthier, ancien président de la Ligue Belge des Droits de l’Homme et avocat d’une des victimes de Dutroux. Mais qu’on ne connaît pas forcément pour ses penchants cinéphiles.
La signataire de l’article, elle-même spécialisée dans la rubrique judiciaire, a jugé bon d’emmener l’avocat et une journaliste de RTL-TVI ayant couvert l’affaire, pour nous donner leur avis éclairé sur un film dont l’affiche mentionne pourtant en toutes lettres “librement inspiré de l’affaire Dutroux”.
Et on a droit à un festival digne de ces vidéos réact sur Youtube, où on ne trouve rien de mieux que de demander à un ancien agent des forces spéciales de critiquer le réalisme de John Wick ou à un ancien mafioso de critiquer un film de Scorcese.
On a ainsi droit à cette remarque, à propos d’une scène qui place les enjeux émotionnels du héros : « Pourquoi se perdre ainsi au lieu d’utiliser ce temps à parler de ce qui est un élément phare du dossier Dutroux ? »
Ou encore “Il y avait des éléments objectifs que le scénariste aurait pu utiliser, il n’y avait pas besoin d’inventer et de semer la confusion.”
Ou encore cette phrase d’un autre avocat, anonyme, qui a refusé d’aller voir et de commenter ce film parce que, je cite : les gens ne font généralement pas, ensuite, la démarche de s’informer sur ce qui était vrai et ce qui est fictif.
Mauvais sujet, ou mauvais public ?
Bien sûr, on pourrait accueillir tout cela d’un haussement d’épaules. Ce genre de réaction est vieille comme le cinéma. Hitchcock se moquait déjà longuement des obsessions des “vraisemblants” lors de ses échanges avec Truffaut.
Mais, tout de même, on ne peut pas s’empêcher de s’interroger. Si les faits sont sacro-saints, ne faut-il pas aussi étriller, je ne sais pas moi, La Zone d’Intérêt, Inglorious Basterds ou Napoléon ? Si la fiction autour des affaires judiciaires est aussi délicate, pourquoi les films de Joachim Lafosse, qui eux aussi s’inspirent tout aussi librement d’affaires judiciaires comme l’affaire Victor Hissel ou Geneviève Lhermitte, ne reçoivent pas le même traitement ?
En fait, ce qui se passe avec Maldoror a, à mon avis, plus à voir avec ce qui s’est passé l’année dernière au BIFFF autour du film Love Lies Bleeding qu’avec la question de faire ou non un film librement inspiré d’une affaire judiciaire, aussi traumatisante soit elle.
Le problème de Maldoror, c’est que c’est un film de genre. Qu’il cherche à s’adresser à un large public et pas qu’aux spectateurs du circuit Art et Essai.
Le retour du mépris
Ce qui s’entend derrière tous ces discours, c’est qu’un certain public - évidemment le public populaire - n’aurait pas le bagage culturel pour comprendre que ce film ne raconte pas les faits réels.
On me rétorquera que les émissions radio grand public ont elles aussi fait cette hypothèse, et que les réactions des auditeurs tendraient à l’accréditer. Si ce n’est que ces émissions ont été faites avant même la sortie du film, avec une question biaisée, et donc demandaient à des gens de se positionner sur un sujet qui n’est pas vraiment celui du film. Film qu’au demeurant personne n’avait encore vu.
Qu’on en joue ou qu’on le craigne, c’est le même mépris qui anime l’émission de radio et l’article. Une manière de dire que le cinéma a perdu son universalité. Qu’il y a des films qu’on ne peut pas montrer à tout le monde. Des sujets qu’on ne peut traiter qu’entre gens de bonne compagnie. Qu’il y a des bons et des mauvais publics.
Et ce en quoi le cas Maldoror restera comme exemplaire, c’est qu’il est peut-être le moment où ce genre de discours est passé en quelques jours de la question rhétorique (Fallait-il faire un film sur l’affaire Dutroux ? ) à l’injonction (N’allez pas voir ce film). Ce pas là est une nouvelle petite défaite pour le cinéma en tant qu’art populaire.