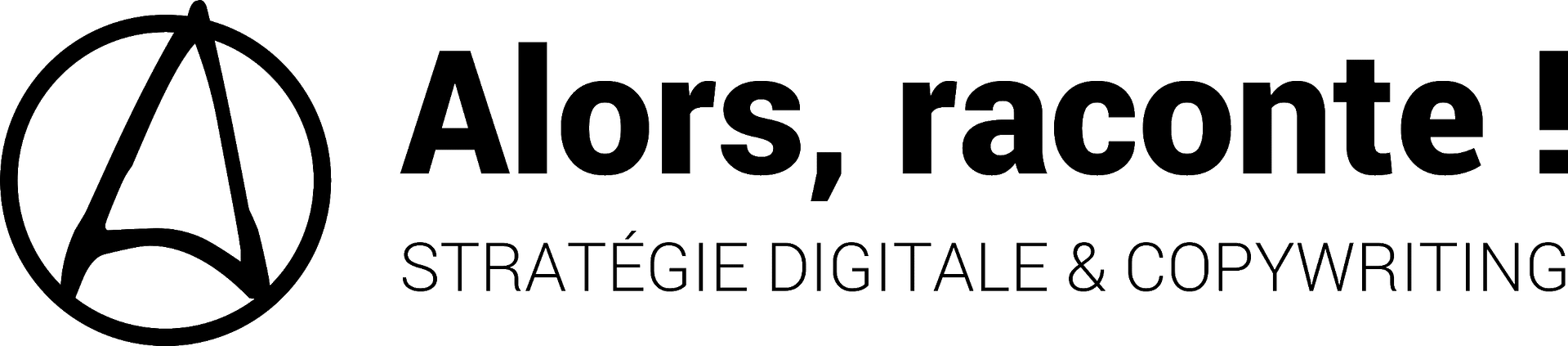Depuis le début du mouvement #MeToo, on assiste à un peu plus qu’un dévoilement public de l’ampleur des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. C’est une remise en cause des mécanismes de pouvoir dans l’industrie, à travers ses abus les plus ignobles, et la manière dont ceux-ci ont été invisibilisés aux cours des années.
A ce titre, le procès de Gérard Depardieu - mais aussi les auditions de l’Assemblée Nationale Française sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu artistique - ont été l’un de ses plus puissants révélateurs. Ce qu’ils ont révélé, c’est que ce ne sont pas uniquement les hommes qui se sont défendus, contre l’avalanche de témoignages concordants. Ce sont les puissants. Ainsi, non seulement la défense de Depardieu a tenté de discréditer les accusatrices en raison de leur position sociale-même dans la hiérarchie du cinéma. Mais ce sont aussi les élites du cinéma (cinéastes, actrices, etc) qui ont juré, devant la barre et ailleurs, ne pas reconnaître l’homme décrit lors du procès. Et on pourrait dire la même chose de ces cinéastes, critiques, gérants d’institutions, agents d’acteurs et d’actrices lors de leurs auditions en commission.
D’où vient le pouvoir ?
On ne reviendra pas ici sur le concept ridicule de cancel culture, qui voudrait que de grands artistes, journalistes, politiciens, soient empêchés de travailler par la seule force d’une masse informe, ignare et vindicative. Alors qu’une vraie cancel culture existe depuis les débuts du cinéma, mais dans l’autre sens. Les livres sur les coulisses du cinéma regorgent de cas d’actrices, de scénaristes ou autres dont le nom a été rayé de la carte par la seule volonté d’un producteur, d’un cinéaste ou d’un acteur. Et le cinéma n’est bien sûr pas le seul art ni la seule industrie dans ce cas.
Par contre, il est peut-être bon de se pencher sur l’origine de ce pouvoir, de cette hiérarchie stricte dans une industrie qui est, plus que tout autre, un effort artistique collectif. Pourquoi les cinéastes sont-ils les auteurs des films ? Pourquoi tant de créateurs essentiels à la fabrique d’un film sont-ils invisibilisés ?
C’est justement à ces questions qu’entreprend de répondre un livre paru récemment : Qu’est-ce qu’un auteur de cinéma? Art, pouvoirs et divisions du travail, de Jérôme Pacouret, paru aux éditions du CNRS. L’ouvrage de 480 pages est lui-même une actualisation de la thèse de doctorat de l’auteur, qui faisait elle près de 800 pages.
L’auteur, un concept variable
D’emblée, Pacouret tord le cou à une légende, qui voudrait que la notion d’auteur attribuée au cinéaste est une invention des futurs auteurs de la Nouvelle Vague. Et qu’elle s’applique au seul cinéma d’auteur, ou indépendant.
En sociologue, Pacouret étudie les rapports de force dès les débuts de l’art cinématographique. Les luttes entre producteurs, scénaristes et cinéastes pour la paternité des films. Pour des raisons bien sûr symboliques, de prestige, mais aussi pécuniaires.
Il souligne aussi que ces rapports varient dans le temps, l’espace et les conditions de production. Il prend ainsi pour exemple My Beautiful Laundrette, connu chez nous comme un film de Stephen Frears, mais considéré en Angleterre plutôt comme un film d’Anif Kureishi, l’auteur de son scénario. Et cela principalement car il s’agit en fait d’un téléfilm, intégralement produit par la BBC.
Ou encore la revalorisation symbolique du métier de scénariste, suite à l’arrivée de l’âge d’or des séries au tournant des années 2000.
Le tournant 68
L’étude de Pacouret regorge de moments historiques phares pour la définition, le rôle et la rémunération des auteurs. Comme les suites de l’annulation du festival de Cannes 1968. Les luttes pour la redéfinition du statut des travailleurs et travailleuses du cinéma ont été âpres dans les Etats Généraux du cinéma convoqués à la suite de ces événements.
Un cinéaste comme Claude Chabrol, par exemple, était partisan d’une dévalorisation du statut d’auteur de film pour le réalisateur, et une redistribution collective des recettes brutes d’un film, soit dès le premier euro engrangé. Contrairement à ce qui se fait actuellement, où ce sont les recettes nettes du producteur, moins les avances sur droits d’auteur qui sont prises en compte. Et seuls les réalisateurs et scénaristes sont concernés par cette redistribution.
Et, bien sûr, des cinéastes ont expérimenté ce travail de dévalorisation du statut du réalisateur dans leur propre travail. On pense à Jacques Rivette et, bien sûr, Jean-Luc Godard. Et surtout à des cinématographies émergentes, comme le Cinéma Novo ou les cinémas issus de la décolonisation.
Mais, comme souvent dans les révolutions, le mouvement de 68 a abouti, au cinéma comme ailleurs, à une reprise en main, peut-être plus sévère encore, du pouvoir par ses détenteurs originels. Car les Etats Généraux ont aussi abouti à la création de la Société des Réalisateurs de film, qui marque la séparation des cinéastes du milieu syndical. Ceux-ci étaient en effet précédemment membres à la fois de la SACD et des sections des arts des syndicats traditionnels, au titre de techniciens du cinéma, comme tous les autres.
La première revendication de la SRF a été de revendiquer la propriété artistique des films pour les réalisateurs. Pas la paternité, ni le seul droit moral. La propriété. C’est de ce moment qu’on peut dater, en France, l’officialisation de la distinction des cinéastes vis à vis des autres travailleurs. Et cette distinction se fait donc sur une question de propriété.
Pouvoir et propriété
Plus que de la Nouvelle Vague, c’est donc plutôt des suites de 68 que date la prédominance, au moins symbolique, du cinéaste dans le cinéma français.
Le livre foisonne de ces luttes de pouvoir entre scénaristes, producteurs et cinéastes. Luttes d’où sont évidemment écartés tous les autres travailleurs et travailleuses du cinéma. En ce compris les comédiens et comédiennes, d’ailleurs, qui n’acquièrent de pouvoir que par procuration des 3 autres catégories.
L’avantage de ce genre de livres, de cette approche sociologique, c’est de rappeler que les positions de pouvoir ne sont jamais uniquement symboliques, sont toujours une question de rapport de forces, et sont en constante renégociations. Le moment que nous vivons est, peut-être, un réarrangement de ce rapport de forces. Avec, bien sûr, le risque qu’il n’aboutisse qu’à l’accession de quelques-uns et quelques-unes aux postes de pouvoir, sans renverser fondamentalement la hiérarchie.
Parce que, comme toujours, ces questions de pouvoir, même dans le milieu artistique, cachent du mieux qu’elles peuvent le véritable enjeu, toujours non-dit : la question de propriété.