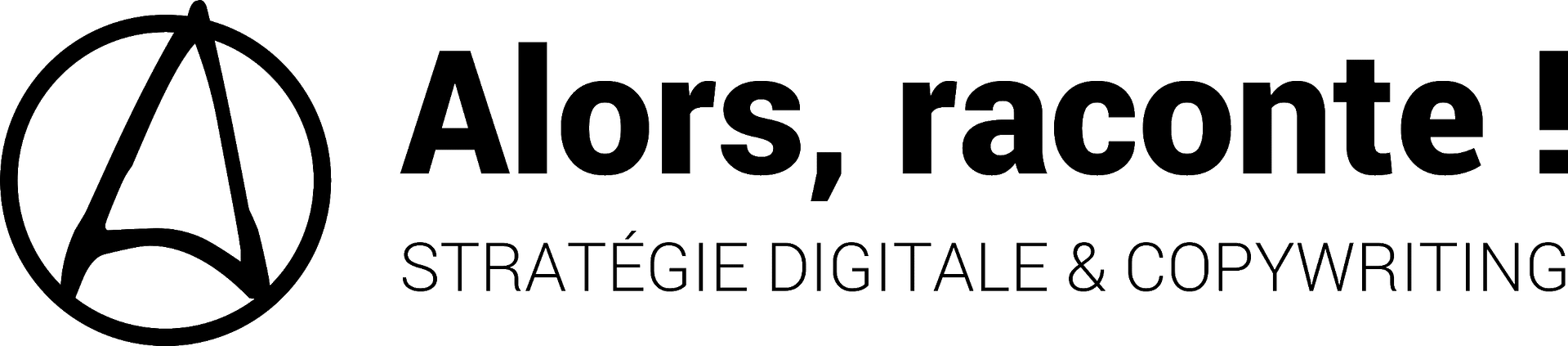Au milieu de cet été, alors que le petit monde du cinéma bruissait aux effets conjugués de Barbenheimer, une petite info passait presque inaperçue : Disney se retirait d’un nouveau marché de la vente de films sur support physique. Désormais, après l’Amérique Latine, l’Australie ne sera plus fournie en DVD et Blu-Ray estampillés Disney.
Les Aussies n’auront désormais qu’à faire comme tout le monde, prendre un abonnement à Disney + (ou à un service d’IPTV, ne nous voilons pas la face).
D’autre part, l’activité historique de Netflix, DVD.com, cessera ses activités le 29 septembre prochain.
Notre quotidien national, Le Soir, se fendait pour l’occasion d’un article pour dire à quel point le support physique n’est plus qu’une affaire de derniers Mohicans.
Et il n’était pas le seul, tout ce que le net compte de médias clickbait titraient sur la fin du format DVD, par cette simple décision de Disney. Rien n’est plus faux, bien sûr. Des DVD et des Blu-ray se vendent encore. Mais force est de constater qu’ils ne sont plus un objet de consommation de masse.
Avant de commencer, une petite précision. J’ai moi-même été un acteur de ce secteur de l’exploitation des films. Pendant environ 10 ans, j’ai accompagné la fin du boom du DVD jusqu’à son lent déclin.
Rassurez-vous, aucune nostalgie de vieux con dans ce qui suivra. Le support avait ses tares, et il est aujourd’hui pénible de remettre une vieille galette dans son lecteur pour se taper trois minutes de bandes annonces et un message non-skippable de la Belgian Antipiracy Foundation, avant d’enfin pouvoir regarder son film … quand une griffe ou un vieillissement inopiné du disque ne le rend pas illisible.
En termes de pur confort égoïste, il n’y a pas photo, il faut bien l’avouer.
Néanmoins, l’heure de cette lente disparition est peut-être le moment de s’interroger sur ce que le passage au tout-streaming a fait à l’industrie du cinéma. Et notamment au cinéma indépendant.
Le dernier support cinéphile ?
Commençons tout de même par un petit moment ouin-ouin. Le DVD, par extension le support physique, était sans doute un moment unique dans la cinéphilie mondiale. Du cinéma asiatique aux trésors de la RKO, du cinéma d’exploitation italien à Glauber Rocha, tout pouvait être disponible. Les canons étaient réévalués. Des auteurs comme Tsui Hark, Dario Argento ou William Friedkin reprenaient leur place dans l’histoire du cinéma.
Bien sûr, l’apparat critique de certains disques laissait à désirer, et se contentait du pur discours promo. Mais, pour d’autres, c’était un véritable discours cinéphile qui accompagnait le film.
Discours amplement relayé sur le net par une horde de bloggeurs, forumistes et collectionneurs amateurs.
Plus rien de tout cela aujourd’hui, ou presque. Les films trop anciens ou trop “de niche” sont relégués sur des plateformes confidentielles. Et le discours purement cinéphile s’étiole et peine à trouver une nouvelle génération.
L’échec de la curation
Cependant, l’ère du streaming, du tout à disposition tout de suite, venait avec sa propre promesse : la curation. Puisque tous les films et toutes les séries sont potentiellement là, en permanence à portée de clic, dans un flux continu de nouveautés, il faudrait bien des guides pour nous diriger dans la jungle des contenus.
Force est de reconnaître que cela n’a jamais été vraiment été le cas, sur aucune plateforme.
Et cela pour deux raisons, à mon avis :
- La promesse de départ était fausse. Tout n’est pas disponible. J’en ai parlé récemment, l’offre de titres disponibles sur les plateformes est en fait en train de se réduire constamment, dans un mouvement double de réduction des coûts de gestion et d’une structuration de l’industrie qui n’est pas adapté à des stratégies globales. Les films sont vendus par territoire et les seuls streameurs arrivant à sortir leur épingle du jeu n’y arrivent que parce qu’ils agissent à l’échelle mondiale.
- La curation n’arrive, en fait, qu’à amplifier l’effet de niche. La curation est sensée venir en opposition au tout-algorithme, à la suggestion qui ne parvient qu’à une reproduction du même.
L’humain contre la machine.
Et le problème de l’humain, c’est sa volonté de se distinguer. D’aller chercher la petite pépite dont personne n’a jamais entendu parler, ou presque.
Or, dans le monde des industries culturelles, la denrée rare, celle après laquelle tout le monde court, c’est le temps. Dans cette configuration, la perle rare est en fait un risque. Celui de perdre du temps avec une fausse découverte. Pour être clair, ce piège de la curation existait déjà dans le monde de la diffusion physique et de la télé de papa, avec les collections Cinema de Quartier de Jean-Pierre Dionnet ou plus récemment la collection Make My Day de Jean-Baptiste Thoret. Seule cette dernière arrive à perdurer dans le temps. Mais justement à un moment où le DVD est lui-même devenu un produit de niche…
La curation est probablement la fausse bonne idée de l’ère du streaming, sensée nous éviter le doomscrolling, tout en attisant notre soif de nouveauté. Or, elle n’est jamais arrivée à égaler ce qu’elle cherche réellement à émuler : le bouche à oreille.
Peut-être qu’une solution à ce problème est plus à trouver du côté de ce que font les plateformes de distribution de jeux vidéo, jouant beaucoup plus sur l’aspect communautaire. Mais ce sera, peut-être, pour une autre chronique.
La fin du risque
Voilà donc pour les changements du point de vue du spectateur. Intéressons-nous maintenant aux films eux-mêmes.
L’apogée du DVD a commencé à la fin des années ‘90. Le pic des ventes se situe en 2004. Ensuite a commencé un lent déclin, qui est devenu réellement problématique vers 2015. Regardons donc ce qu'il s’est produit lors de ces années.
Si on regarde le haut du Box Office, ce sont les années du début des grosses licences : Matrix, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man et X-Men. L’ère des blockbusters atteint une nouvelle dimension. Pourquoi ? Parce que le risque d’un succès moins important en salles pouvait être contrebalancé par des ventes en support physique, dont les recettes atteignaient parfois l’équivalent du box office.
Avec le DVD commençait une longue traîne de ventes, qui pouvait s’étaler sur 5 ans voire plus, avec les repackagings, les éditions spéciales, les offres en bundle, etc.
Un projet comme le Seigneur des Anneaux, trilogie éléphantesque, n’aurait sans doute pas pu être imaginé à une autre époque que celle-là. Pas plus que des sagas basées sur des livres pour enfants, ou sur des comics.
Mais c’est plutôt le milieu du panier qui a le plus pu profiter de cette aubaine. Cette période est peut-être le début de l’âge des énormes licences, c’est aussi un âge d’or de la comédie américaine. Les films des Frères Farrelly, d’Adam Sandler, de Ben Stiller et Judd Apatow sont des succès honorables en salle (surtout américaines) mais surtout de gros cartons des rayonnages.
C’est aussi l’âge d’or pour des gens comme Quentin Tarantino (lui même rat de vidéothèque) ou même Clint Eastwood, qui signe ses plus gros succès à l’époque. On pourrait aussi citer Michel Gondry, Spike Jonze et tant d’autres.
Et la même chose peut se dire de l’Europe. Des films relativement ambitieux comme des films de genre commencent à apparaître, avec l’Espagne comme plaque tournante. Et sans aucun doute qu’un film comme The Artist, film muet avec des acteurs à l’époque méconnus, n’aurait pas pu se faire si la période n’avait pas été aussi commercialement propice.
Le cinéma du milieu, c’est par où ?
Les grands perdants de la fin de cet hypothétique âge d’or, ce sont donc les films à moyen budget. Les plus petites productions, audacieuses, irrévérencieuses, parfois un peu bancales.
Si ce n’est qu’en fait, elles n’ont pas complètement disparu. Elles ont été avalées. Les énormes blockbusters, américains mais aussi européens, sont aussi des comédies potaches, des films d’horreur parfois gore voire, parfois, des tord-neurones à envolées philosophiques.
Les réalisateurs des tentpole-movies actuels sont les auteurs ayant émergé à cette époque. Comme James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et nouveau directeur artistique de DC, qui est un ancien réalisateur de cinéma gore. Ou celui des deux derniers Thor, Taika Waititi, qui faisait des films absurdes en Nouvelle Zélande. Ou encore les frères Russo, réalisateurs des Avengers, qui ont fait leurs premières armes en télé, sur la série Community de Dan Harmon.
Tout cela n’est que le cours normal des choses. Les outsiders d’un temps deviennent les auteurs-phare du suivant. Si ce n’est que personne n’est venu les remplacer. Les budgets moyens, source de la vitalité et de la recherche de nouvelles formes, ont tout simplement disparu. On se retrouve aujourd’hui avec des blockbusters tournant entre 150 et 300 millions de dollars de budget (hors marketing) d'un côté, et de l’autre des petits films d’horreur à 20 ou 30 millions maximum.
Ne reste au milieu qu’un cinéma d’auteur pour grands festivals. Poor Things, par exemple, qui a remporté le dernier Lion d’Or à Venise, a ainsi couté 70 millions de dollars.
Tout le reste se retrouve maintenant sur les plateformes … qui commencent elles-mêmes à ne plus vouloir prendre de risques et se focaliser sur de plus gros budgets.
La distribution fragilisée
Mais il y a un autre secteur qui se trouve lui aussi complètement chamboulé par la nouvelle donne : la distribution.
On le sait, la distribution est un des maillons à haut risque de la chaîne du cinéma. En milieu de chaîne, c’est lui qui subit le plus la pression financière dans le circuit. Le DVD, dont les ventes lui remontaient directement à un niveau national, était un régulateur parfait de la trésorerie, amenant un flux régulier, et rapide, de liquidités.
Certes, les choses n’ont jamais été faciles, et les négociations avec les grosses plateformes de ventes rognaient déjà dangereusement sur les marges. Mais les choses sont tout autres aujourd’hui. Les interlocuteurs ne sont plus, ou presque, au niveau national. Ce sont les Amazon, les Mubi et consorts. Qui sont tous en position de pouvoir dicter leurs propres règles.
Difficile de savoir, bien sûr, si les flux financiers compensent ceux de l’époque du DVD.
Ceci étant, entre la pression accrue sur les films de moyenne gamme, due à leur raréfaction, une moindre maîtrise du flux commercial de leurs films, et une attaque en règle par les grands studios des fenêtres d’exploitation, les distributeurs subissent de tous les flancs le changement de modèle économique.
Le bon vieux temps ne reviendra pas
Alors, bien sûr, inutile de se lamenter, ou de chercher à revenir au “bon vieux temps”. Néanmoins après maintenant près de 10 ans de déclin, on peut commencer à voir la trace qu’a laissée les 15 ans de domination du DVD sur l’industrie du cinéma.
Le DVD parvenait encore à maintenir floue la frontière entre le marché de niche et le marché de masse. Ce flou, c’est ce qui remplit en grande partie ce qu’on a appelé le cinéma indépendant, une catégorie fourre-tout qui pouvait aller de films de studios osés à des propositions de cinéma pointues.
Ne reste aujourd’hui que les blockbusters, les films de genre à petit budget et, pour tout milieu, un cinéma d’Art et Essai plus ou moins académique.
Mais, comme tout dans ce bas monde, le cinéma fonctionne par cycles. Nous verrons bien ce que les prochains nous apporteront.