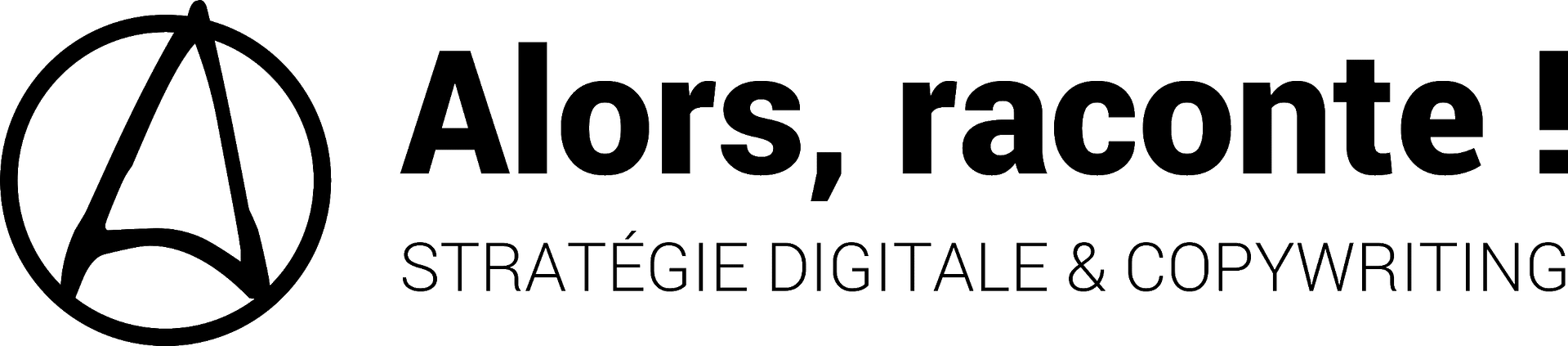Elle est partout. Depuis le début du mois d’octobre, tous les médias professionnels de cinéma fourmillent d’articles sur Taylor Swift et son succès en salles. On la voit, dans sa combinaison à paillettes, la bouche grande ouverte ou bandant son biceps gauche, comme une sportive qui vient de signer un exploit.
Et l’exploit est bien réel. La captation de son concert Eras Tour a engrangé 100 millions de dollars de revenus en Amérique du Nord, rien qu’en préventes.
Il y a énormément de choses à dire sur ce succès, que je vais essayer de dérouler dans cette chronique. Mais le première chose à dire, la plus saillante, a trait à une question d’initiés.
The Eras Tour, le film, est le premier film qui exploite la fin de la loi antitrust dans le milieu du cinéma, entrée en vigueur en 2020.
La fin de la loi antitrust
Petit retour en arrière. En 1948, la loi antitrust qui empêche les studios de posséder leurs propres chaînes de cinéma, ce qui leur donnait un monopole de fait sur l’exploitation de leur propres films, est actée, après 10 ans de bataille juridique. La branche exploitation doit désormais être indépendante des branches production et distribution du cinéma. Inversement, un exploitant ne peut pas devenir distributeur ou producteur. Cette décision a marqué la fin du système des studios.
Cela jusqu’en 2020, donc. Naïvement, comme sans doute beaucoup, j’ai cru que des acteurs comme Amazon ou Netflix allaient sauter sur l’occasion et racheter l’une ou l’autre grande chaîne de multiplexes, en grande difficulté à cette même époque. Grossière erreur. Il est fort probable que les géants de la Silicon Valley n’ont aucune envie de se retrouver avec de l’immobilier sur les bras.
Ce que je n’avais pas vu venir, c’est que les exploitants allaient saisir l’occasion pour diversifier leur offre de contenus. Parce que ne nous leurrons pas, c’est bien de cela dont on parle ici, pas de cinéma.
A cette aune, Taylor Swift est le ballon d’essai idéal. A 34 ans, la chanteuse est au sommet de sa gloire. Elle poursuit depuis plusieurs années une voie vers l’indépendance artistique et financière en se coupant du maximum d’intermédiaires possibles entre elle et ses fans.
Se passer d’intermédiaires
Ce qu’elle fait encore avec ce concert filmé. Son père, gestionnaire de la carrière de Swift et financier avisé, a certes été voir les grands studios pour distribuer ce film. Et beaucoup auraient semble-t-il accepté. Si ce n’est que leur planning ne leur permettait pas de sortir le film avant 2024, voire 2025. Or, les Swift voulaient que le film sorte en octobre 2023, au cours de la tournée elle-même.
Puisqu’aucun distributeur installé ne lui donnait satisfaction, Swift a décidé de se passer d’eux, et de négocier directement avec la principale chaîne de multiplexes américaine, AMC. Ceux-ci gardent 43% des recettes du film, pour l’exploitation et la distribution, Swift 57%.
Un très bon deal pour les deux parties, possible uniquement parce qu’il n’y a pas d’autre intermédiaire.
Bien sûr, on pourrait arguer qu’en agissant de la sorte, Swift se coupe d’un box-office bien supérieur, qu’aurait pu lui apporter la machine de guerre promotionnelle d’un grand distributeur/studio.
Mais pouvait-il s’assurer de meilleures recette nettes ? On peut sérieusement en douter.
D’autant que, je le répète, ce film est du contenu. Une source de revenu au sein d’une stratégie commerciale beaucoup plus large. Comme Barbie, en fait.
Content is king
Si ce film existe, et si les Swift tenaient tellement à ce qu’il sorte en octobre 2023, c’est parce qu’il est pensé comme un complément à la tournée mondiale. Presque tous les concerts de Swift, qui se déroulent pourtant dans des stades, sont sold out. Les fans hardcore vont de l’autre côté du monde pour avoir une chance d’assister aux concerts.
Les concerts, on le sait, sont redevenus la principale source de revenu des musiciens, après la radicale transformation du marché de la musique dans les années 2000. En conséquence, le prix d’un concert, ou d’un pass dans un festival, s’est envolé.
Beaucoup, surtout parmi les plus jeunes, ne peuvent tout simplement plus se le permettre. C’est là qu’intervient le film. Ou plutôt l’expérience cinéma. Accéder, à moindre coût, à l’expérience du concert, dans une mini-salle de concert : les cinémas.
Il faut d’ailleurs signaler un petit détail, dans cette succes-story. Le prix de la place de cinéma est sensiblement supérieur à un ticket normal, même aux standards américains. Une place se vend 19,89$, en référence à l’année de naissance de la chanteuse et au titre de l’un de ses albums. Et il n’y a pas de ristourne possible.
Un rapide calcul nous donne donc le chiffre de plus de 5 millions de tickets prévendus, propulsant le film au sommet du box-office le jour de sa sortie, où il est encore, à la deuxième semaine de son exploitation.
Si l’opération est clairement une nouvelle réussite pour l’entreprise Swift, est-elle vraiment une nouvelle opportunité pour les salles de cinéma ?
Qui gagne ?
Tout d’abord, il faut s’entendre sur les termes. Ce n’est pas vraiment les cinémas qui profitent de cette bouffée d’air frais, mais les multiplexes. Avec la raréfaction des blockbusters, et leurs recettes sensiblement moins élevées qu’avant le rush du streaming, les cinémas, et plus particulièrement les multiplexes, se doivent de diversifier leur offre.
Comme le dit l’un des exploitants américains - et ce que disent aussi les gérants de multiplexes chez nous - c’est qu’ils ne sont désormais plus dans le business du cinéma. Leur business, c’est de réunir des gens autour d’expériences.
Et, mine de rien, c’est une tout autre affaire.
Jusqu’ici, un exploitant de salles était un prestataire de services. Il fournissait de l’espace (un ou plusieurs écrans) aux distributeurs, entourés d’une série de services pour les spectateurs. A boire, à manger, des toilettes. Dans ce sens, il est entièrement dépendant de ses fournisseurs.
Créer de l’expérience, c’est autre chose. C’est de l’organisation d’événement. Avoir quelque-chose à mettre sur son écran ne suffit plus. Projeter un concert, un opéra, une pièce de théâtre, un tournoi de jeux vidéos a intérêt à avoir une plus-value bien plus importante, ou en tout cas fort différente, de l’activité réelle. Ce qui est filmé ne peut pas être mieux - comment pourrait-il l’être - il doit proposer une expérience suffisamment différente pour attirer ceux qui ont déjà été au concert, ou voulaient absolument y assister mais n’ont pas pu. Ce sont eux, le coeur de cible. Si ils ne se déplacent pas, les cibles secondaires ne le feront pas non plus.
Tailor Swift, avec sa horde de fans hardcore, est à cette aune un pari facile. Comme l’est sans doute le concert filmé de Beyoncé qui est annoncé en décembre. Mais combien d’autres artistes sont capables d’attirer les foules à un niveau tel que l’activité reste rentable ?
Une filière d’avenir ?
Le public de ces séances est très différent. Il chante, danse, prend des selfies, allume la torche de son téléphone. Impossible de croire que ce genre d’activités n’endommage pas plus rapidement l’infrastructure. Entraînant, sur le long terme des coûts de maintenance accrus. Ajoutez à cela les coûts de promotion, supportés par les salles puisqu’ils sont de facto les distributeurs du film, et voilà une activité dont la marge se réduit grandement.
D’autant que les chiffres annoncés, pour impressionnants qu’ils sont, ne le sont pas tant que ça à l’échelle historique. Un film comme Woodstock, en 1970, véritable documentaire pour le coup, a rapporté en son temps l’équivalent, corrigé par l’inflation, de 400 millions de dollars. Uniquement parce qu’il était porté par un mouvement culturel et social d’ampleur mondiale.
Ce que ne sont ni Swift ni Beyoncé, malgré leur succès insolent.
La question reste donc posée. Ce genre d’expériences est-il vraiment une nouvelle source de revenus pour les multiplexes, à long terme ? Ou est-elle juste une bouffée d’air frais, temporaire, qui leur permettra de passer à travers les turbulences ?
Personne n’a de boule de cristal. Mais ce qui est sûr, c’est que nous assistons à un nouvel avatar de la transformation de nos industries de la création en industries de contenus.
Ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Mais il va falloir l’assumer.